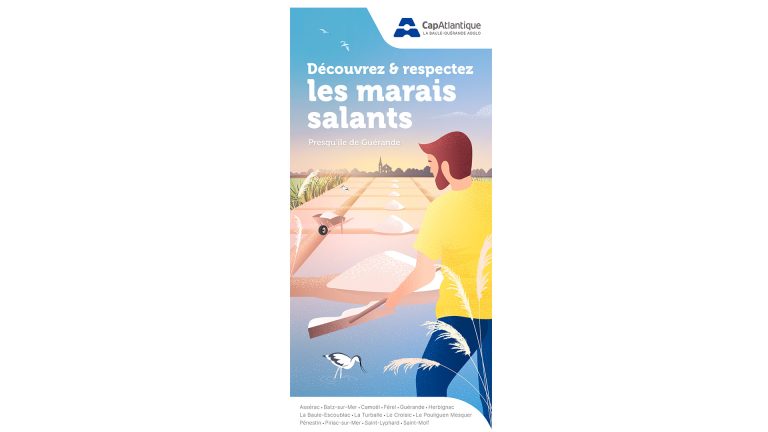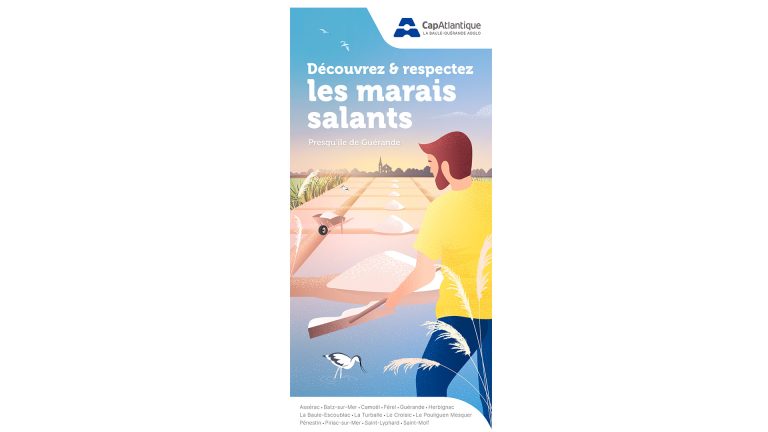
Transmettre l’histoire du sel de la Presqu’île Guérandaise
Depuis près de 2 000 ans, les marais salants de Guérande façonnent le paysage et la vie de la Presqu’île. Entre avancées et reculs, reconstructions et réaménagements, cet espace unique témoigne d’un savoir-faire ancestral, toujours vivant aujourd’hui.
2 000 ans d’aménagement durable
Contrairement à une idée reçue, l’aménagement de l’espace salicole ne s’est pas fait de manière continue. Depuis l’Antiquité, la colonisation du littoral a connu des phases d’expansion et de recul. Certaines salines, tombées en friche, ont été reprises et remembrées à différentes époques, bien avant le XIIIe siècle.
Du XIXe à aujourd’hui
Au XIXe siècle, la région située entre les estuaires de La Loire et de La Vilaine comptait deux autres bassins salicoles totalisant 46 hectares (bassin de Saint-Nazaire/Pornichet et bassin de Pénestin). Les salines guérandaises ont connu leur plus grande expansion territoriale vers 1850. Les quatre bassins rassemblaient alors près de 33 400 œillets, cultivés par 950 familles de paludiers.
Aujourd’hui, la Presqu’île guérandaise compte environ 1 850 hectares de marais salants, répartis en deux bassins distants d’une vingtaine de kilomètres : le bassin du Mès (350 hectares) et le bassin de Batz-Guérande (1 500 hectares).
Les marais salants en quelques chiffres
-
paludiers dont 40 femmes
-
œillets entretenus par les paludiers
-
tonnes de fleur de sel par an
-
tonnes de gros sels par an
Respectez ce paysage qui traverse l’histoire